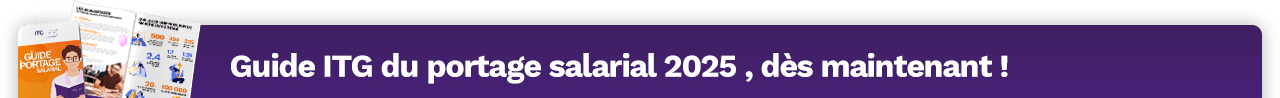Le portage salarial pour les travailleurs des plateformes ? (Partie 1)
Les conclusions tant attendues du rapport FROUIN concernant les travailleurs des plateformes sont enfin tombées : le portage salarial et les coopératives d’activité et d’emploi seraient, selon les auteurs du rapport, les véhicules juridiques idéaux pour ces travailleurs d’un nouveau genre. L’équipe du Guide vous livre son analyse du rapport en deux parties !
Nous avons beaucoup écrit sur les travailleurs des plateformes en 2020, l’actualité a en effet été riche et passionnante sur le sujet, entre les différentes missions commanditées par le gouvernement, l’arrêt de la Cour de cassation du mois de mars qui est venu ébranler le modèle économique des plateformes et même l’actualité internationale, notamment en Californie. Sujet passionnant donc, d’autant que ce qui se limite aujourd’hui aux plateformes dites de mobilité, tenues à une responsabilité sociale, est à même de se généraliser dans les années à venir à de nombreux secteurs d’activité.
C’est donc en toute logique que nous avons pris le temps de lire avec attention le rapport FROUIN. Ses conclusions vont dans un sens qui en a surpris plus d’un, nous un peu moins, à savoir proposer comme solution à l’épineux problème du statut des travailleurs des plateformes le portage salarial et la coopérative d’activité et d’emploi !
Disons-le tout de suite, nous avons adoré l’ensemble du rapport et la qualité du travail effectué, mais nous n’allons volontairement pas traiter la partie dialogue social, qui, bien que passionnante, est un sujet à part entière. On notera d’ailleurs qu’un nouveau groupe de travail a été missionné par le gouvernement pour parachever le travail déjà commencé (et bien avancé) de la mission FROUIN sur le sujet.
Nous vous proposons donc un décryptage maison du rapport en deux parties (cela méritait au moins cela), avec les solutions exclues dans la première et les solutions retenues pour la seconde, en vous les détaillant dans le menu !
Les solutions exclues du rapport FROUIN : le salariat, le tiers-statut et le statu quo
Pour bien comprendre ce qui a conduit Jean-Yves FROUIN sur la voie du « tiers sécurisateur » et donc naturellement vers le portage salarial et la coopérative d’activité, il nous a semblé important d’analyser les solutions qui s’offraient en réalité à lui.
Rappelons tout d’abord quelle était la commande du gouvernement donnée à la seconde mission FROUIN. Outre la question du dialogue social, il revenait à la mission de « définir les voies et moyens
permettant de sécuriser juridiquement les relations contractuelles (…) conclus entre les plateformes et ces travailleurs et d’identifier les pistes permettant de renforcer le socle de droits dont bénéficient les travailleurs des plateformes, sans remettre en cause la flexibilité apportée par le statut d’indépendant ».
En d’autres termes, la commande du gouvernement était de trouver une solution juridique pour à la fois protéger et renforcer les droits les travailleurs des plateformes numériques définis dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), tout en préservant le modèle économique des plateformes, en limitant (ou supprimant comme le voulait le gouvernement avec les chartes) le contentieux relatif à la requalification contractuelle ! De fait était exclue dans la lettre de mission la possibilité de suivre la position de la Cour de cassation en laissant lesdits travailleurs devenir des salariés des plateformes.
La solution du salariat pour les travailleurs des plateformes : une hypothèse écartée de fait
La décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020 dont nous avons parlé en introduction a eu un effet salvateur : pousser le gouvernement à s’occuper (une fois pour toute) de la situation complexe des travailleurs des plateformes. Alors que la Haute Juridiction donne tous les arguments pour qualifier les chauffeurs VTC en salariés, cette solution n’est pas du tout (mais alors pas du tout) souhaitée par le gouvernement, ni forcément en adéquation avec les enjeux en présence.
Autres arguments que la volonté farouche du gouvernement de ne pas considérer les travailleurs des plateformes comme salariés ? Eh bien les plateformes arguent par exemple que leurs travailleurs souhaitent rester indépendants, résultats de sondages à l’appui !
Certes, elles organisent elles-mêmes les sondages me direz-vous…
Plus sérieusement, le rapport évoque d’autres arguments pour écarter le salariat.
Le rapport relève ainsi que « tous les travailleurs des plateformes ne sont pas placés dans la même situation de « dépendance économique » à l’égard des plateformes, certains de ces travailleurs ne relevant guère d’une qualification de salarié. Il conviendrait donc en toute hypothèse de distinguer selon les plateformes et selon les travailleurs. »
On notera en effet que pour de nombreux chauffeurs ou livreurs, il s’agit d’une activité secondaire, et que pour beaucoup également il est plus simple d’accéder à cette activité sous la forme de la micro-entreprise plutôt que de passer par un recrutement traditionnel au vu des « difficultés d’accès à l’emploi » qu’ils peuvent connaître par ailleurs.
Mais au-delà de la question du bien-fondé de ces arguments, encore une fois, ne nous y trompons pas, la commande du gouvernement ne permettait pas de généraliser le salariat pour ce type de travailleurs.
La solution du tiers statut : non, de chez non !
La question du troisième statut n’est pas nouvelle et s’est réinvitée avec force dans le débat public à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars dernier.
Le rapport pointe avec justesse d’une part les risques d’insécurité juridique induits par la création d’un troisième statut qui reviendrait à « remplacer une frontière floue par deux frontières qui le seraient tout autant », qui risquerait mécaniquement d’augmenter le contentieux de la requalification, alors que l’objectif était de le limiter…
D’autre part, « au lieu de servir l’objectif d’étendre les réglementations protectrices au plus grand nombre, ce statut créerait un nivellement par le bas » avec en effet l’apparition d’un risque de concurrence déloyale et de dumping social entre indépendants soumis à des régimes différents, exerçant pourtant des activités similaires dans des conditions sensiblement identiques.
Et le rapport d’ajouter que « le tiers statut ne résout en rien la question statutaire, puisque les pays l’ayant adopté, comme l’Espagne et l’Italie, cherchent à nouveau un statut juridique spécifique,
adapté aux travailleurs des plateformes » … CQFD
Surcroît de contentieux, complexité juridique supplémentaire, dumping social, on oublie…
La solution du statu quo : oui, mais non !
Statu quo signifie rester en l’état où cela était précédemment. On sent tout de suite la limite de l’exercice. Dans le cadre du rapport, cela signifie toujours considérer les travailleurs des plateformes
comme des indépendants, comme c’est le cas aujourd’hui, mais trouver des solutions pour limiter les risques de contentieux, tout en les protégeant socialement par ailleurs.
Deux options possibles de statu quo sont envisagées dans le rapport : un statu quo (presque) « pur et simple » et un statu quo avec une tentative de sécurisation juridique.
Un statu quo (presque) « pur et simple » :
L’idée est ici, pour le reprendre le rapport, de maintenir pour les travailleurs des plateformes « un statut de travailleur indépendant mais en réalité intermédiaire doté de certains des droits applicables aux salariés ».
On rappellera à toutes fins utiles que ces travailleurs bénéficient déjà d’une réglementation spécifique inscrite dans la septième partie du Code du travail qui s’intitule « Dispositions particulières à certaines professions et activités » : le chemin est donc déjà arpenté, il suffirait d’aller au bout en quelque sorte.
L’hypothèse envisagée dans le rapport est donc de laisser la situation en l’état, et de ne pas toucher à leur statut juridique (ou régime pour les plus pointilleux), mais de renforcer leur protection sociale, par
exemple en les assimilant par la loi au régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, grâce à la mise en place d’un « dialogue social » adapté, leurs droits et protection seraient complétés, et l’on pourrait (peut-être) en pratique limiter les contentieux !
Et c’est là, avec ce « peut-être », que le bât blesse, car en effet, cette solution ne réglerait en rien les risques de saisine des juges possibles en matière de requalification par les travailleurs vis-à-vis de
leurs plateformes.
Un statu quo avec tentative de sécurisation
La seconde hypothèse est de toujours considérer les chauffeurs et autres livreurs comme des indépendants, mais en sécurisant juridiquement cette notion, là encore pour éviter le contentieux de la requalification !
Cette sécurisation reviendrait à faire disparaître les indices d’un lien de subordination en donnant une définition du travail indépendant par exemple en précisant des critères comme la constitution de leur propre clientèle, la fixation de leurs tarifs et des conditions d’exécution de leur prestation. L’annexe 4 du rapport donne à cet égard un exemple de ce que pourrait donner la rédaction d’une telle définition pour les travailleurs indépendants réalisant leurs prestations pour certaines plateformes. En effet, aujourd’hui, un travailleur indépendant se définit en creux, par opposition au salariat et à la présence, ou non, des critères qui composent la subordination qui le caractérise.
Mais encore une fois, une telle définition ne rendrait pas inopérante la requalification demandée par les travailleurs des plateformes, ou celle de n’importe quel indépendant par ailleurs, elle pourrait seulement « limiter » les recours, si et seulement si les critères prédéfinis sont bien respectés.
On ajoutera que la mise en place d’une présomption irréfragable (c’est-à-dire incontestable devant le juge) de travail indépendant est contraire à la Constitution… donc le juge pourra toujours être saisi (Et c’est tant mieux !)
La conclusion du rapport n’est dès lors pas très surprenante, « aucune de ces quatre solutions n’est réellement satisfaisante, ne permettant pas tout à la fois de garantir les droits des travailleurs,
l’autonomie d’exercice et de sécuriser les relations contractuelles ».
Alors que d’autres le sont peut-être ? Rendez-vous très vite pour la partie 2 !

Articles
connexes
- Le portage salarial est-il une solution pour les travailleurs des plateformes ? Partie 2
- Les 3 grandes catégories d’entreprises de portage salarial en 2020
- Freelance en portage salarial, qui es-tu ?
- Portage salarial : quels avantages pour l’accès à la formation professionnelle ?
- Vers un « statut unique » pour les travailleurs des plateformes ?