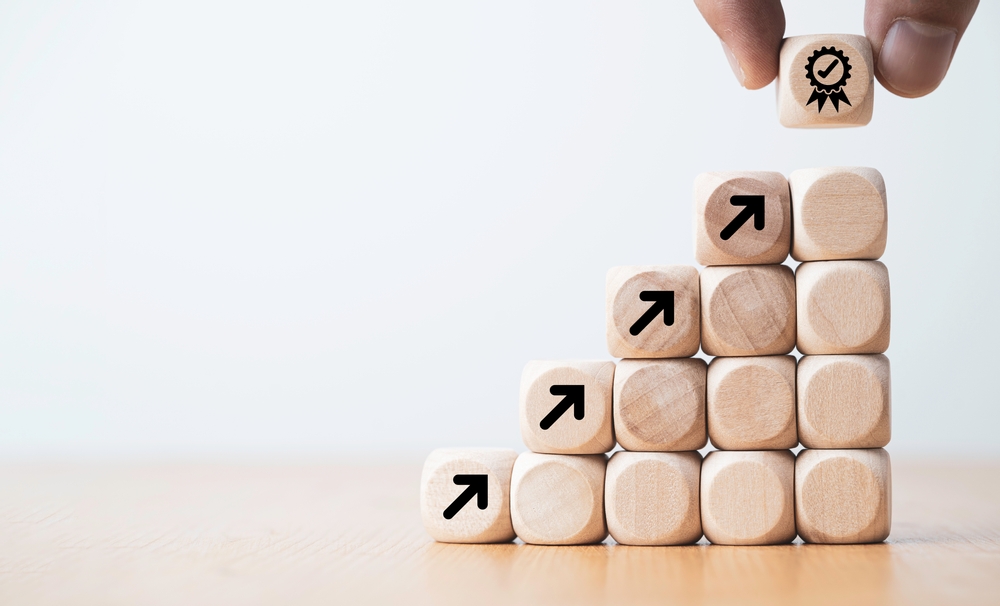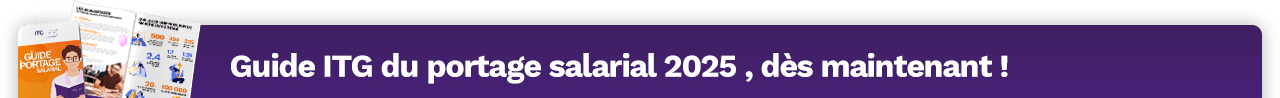La réforme de l’Assurance Chômage : où en sommes-nous ?
Ces derniers mois, nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de vous parler de la réforme de l’assurance chômage :
Force est de constater qu’il n’a pas été simple ces derniers mois de suivre l’application de la réforme. Entre reports du fait de la crise sanitaire, publications successives de décrets venant modifier les règles et suspension par le Conseil d’Etat, impossible d’y voir clair sans être expert du sujet.
À l’approche de la fin de l’année, essayons de démêler tout cela.
Le point sur la situation en deux épisodes
Les étapes précédentes
En 2017, les partenaires sociaux signent une nouvelle convention d’assurance chômage, déterminant les règles du système. Les organisations d’employeurs comme les organisations de salariés jugent alors que le texte est « équilibré ». Ce dernier porte alors notamment sur :
- Les conditions minimales d’affiliation au régime.
- Une régulation confiée aux branches pour les contrats courts.
Durant cette même année, Emmanuel Macron devient président de la République. Dans son programme, il porte notamment :
- « L’universalisation » de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants et aux démissionnaires.
- L’instauration d’une gouvernance tripartite (Etat – Organisation patronale – Organisation salariée) de l’Unédic.
Dans le cadre du projet du gouvernement, les partenaires sociaux sont invités à négocier un accord national interprofessionnel. Ceux-ci arrivent à un accord le 22 février 2018, dont les mesures sont reprises dans la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Cependant, au cours de l’été 2018, le président de la République décide de rouvrir les discussions relatives aux règles de l’assurance chômage, arguant que celles-ci encourageraient « involontairement » la précarité.
Après plusieurs négociations et une impasse sur la question des contrats courts, les partenaires sociaux laissent finalement à l’Etat le soin de fixer par décret les nouvelles règles du système en février 2019.
Les décrets de 2019
En juin 2019, le Premier Ministre Edouard Philippe dévoile les objectifs de la réforme :
- La lutte contre les contrats courts (avec un système de bonus-malus).
- La dégressivité des indemnisations.
- La redéfinition du rôle des partenaires sociaux.
Ces annonces donnent lieu à plusieurs décrets publiés le 28 juillet 2019. Parmi les mesures entrées en vigueur au 1er novembre 2019 :
- Conditions d’accès à l’assurance chômage : avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois.
- Droits rechargeables : alignement sur les conditions d’ouverture des droits.
- Dégressivité : application à partir du 7e mois pour les revenus supérieurs à 4 500€ brut.
- Droits des démissionnaires : sous conditions d’un projet professionnel jugé « réel et sérieux ».
- Indépendants : accès sous conditions de ressources et d’activité.
Le bonus-malus, prévu pour entrer en vigueur en 2021, est vivement contesté et fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat.
La crise sanitaire et ses impacts
Avec la crise sanitaire de 2020, plusieurs mesures sont reportées :
- Report des nouvelles règles de calcul de l’indemnisation.
- Neutralisation de certaines périodes (mars-mai 2020) pour le calcul des indemnisations.
- Prolongation des droits des demandeurs d’emploi en fin de droit.
Une conférence sociale en juillet 2020 décide de nouveaux reports au 1er janvier 2021.
Toutefois, avec la deuxième vague épidémique et un nouveau confinement, l’entrée en vigueur des nouvelles mesures est encore repoussée au 1er avril 2021.
Le Conseil d’Etat et les derniers ajustements
En novembre 2020, le Conseil d’Etat rend une décision majeure :
Il invalide les nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence (SJR) en raison de leur impact disproportionné sur certains bénéficiaires.
Il remet en cause le bonus-malus pour des raisons de légalité.
Le gouvernement ajuste alors la réforme en repoussant encore son application à 2022.
Bilan à fin 2020
- Le bonus-malus a disparu.
- Le calcul du SJR reste celui de la convention de 2017.
- La dégressivité s’applique à partir du 1er avril 2021.
- La durée minimale d’affiliation reste fixée à 4 mois jusqu’au 1er avril 2021.
- Les périodes des confinements sont neutralisées pour le calcul des indemnisations.
La réforme de l’assurance chômage a connu de nombreuses évolutions et fait face à des controverses persistantes. Entre ajustements politiques, contestations juridiques et crise sanitaire, elle peine encore à être pleinement appliquée. Reste à voir si les nouvelles mesures prévues pour 2022 seront, cette fois, définitivement mises en place.

Articles
connexes